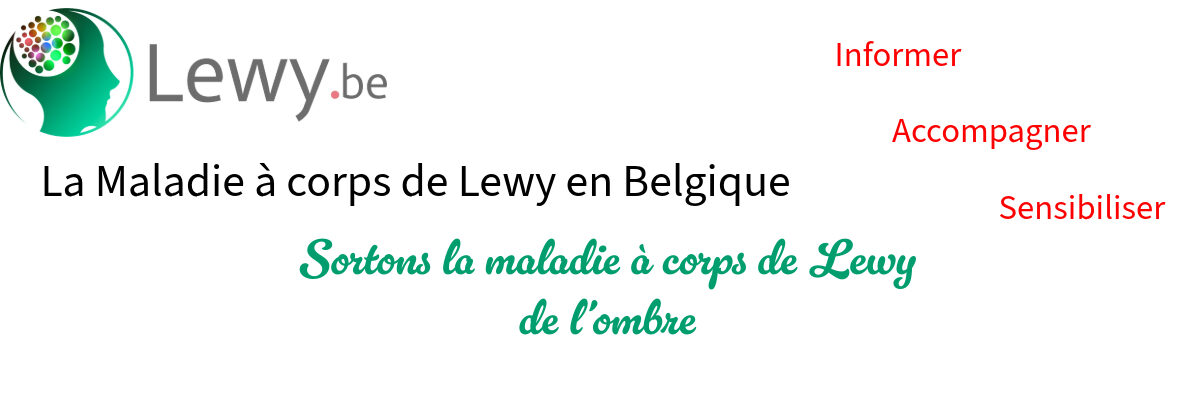Views: 2
Troubles visuo – spatiaux et visuo – perceptifs
Nature du trouble
- Les patients présentent des difficultés à percevoir la position dans l’espace, la profondeur, les objets et leurs relations spatiales
- On observe une altération des capacités de construction visuo‑spatiale (ex : dessin, repérage)
- Ces troubles peuvent contribuer aux hallucinations visuelles, aux erreurs de navigation, aux chutes ou aux maladresses.
Implications pour la prise en charge
- Adapter l’environnement : éclairage suffisant, repères visuels clairs, diminution des stimuli perturbateurs pour limiter la confusion visuelle.
- Proposer des aides visuelles pour orientation/spatialité (planches contrastées, marquage des sols, gestion des obstacles).
- Ajuster les activités de rééducation visuo‑spatiale/perceptive : exercices ciblés (copie de formes, repérage d’objets dans l’espace, tâches de rotation mentale) en tenant compte de la fatigabilité et des fluctuations.
- Tenir compte de la fluctuation cognitive typique de la MCL : planifier les séances aux moments où le patient est le plus alerte.
Troubles du langage
Nature du trouble
- Le langage n’est pas le domaine le plus touché en premier lieu dans la MCL, mais des difficultés apparaissent, notamment : troubles de la fluence verbale (phonémique ou sémantique), recherche de mots, compréhension de phrases complexes.
- Le discours peut devenir désorganisé en période de fluctuation cognitive.
- Il peut y avoir des troubles de la communication pragmatique (organisation du discours, capacité à suivre une conversation complexe).
Implications pour la prise en charge
- Évaluer le langage dans une session où le patient est alerte, en tenant compte des fluctuations.
- Utiliser des stratégies de compensation : simplification du discours, pauses, reformulations, repères visuels ou écrits pour soutenir la compréhension.
- Intégrer des exercices de fluence et de dénomination adaptés, mais avec attente modérée quant aux progrès : l’objectif est souvent le maintien ou le ralentissement de la perte.
- Former les aidants à adopter une communication adaptée (par ex. langage clair, phrases simples, vérification de la compréhension, encourager l’expression).
Troubles des fonctions exécutives
Nature du trouble
- Les fonctions exécutives (planification, initiation, organisation, flexibilité cognitive, multitâche) sont fréquemment altérées dans la MCL.
- L’inattention, la lenteur de traitement, les fluctuations de l’éveil/attention participent à ces troubles.
- Ces troubles ont un fort impact sur les activités de la vie quotidienne : gestion des finances, planification des repas, navigation, conduite.
Implications pour la prise en charge
- Structurer les activités de la vie quotidienne : utiliser des routines, des check‑lists, des supports visuels pour guider les étapes de la tâche.
- Adapter les tâches pour limiter la nécessité de multitâche ou de transition rapide entre activités.
- Favoriser les exercices cognitifs ciblés : résolution de problème simple, jeux de stratégie adaptés, entraînement de la flexibilité (ex : changer de règle) mais avec modération et adaptation.
- Former les aidants à soutenir l’initiation et l’organisation des tâches, à anticiper les besoins, à simplifier l’environnement pour limiter la charge cognitive.
- Prendre en compte la fluctuation : choisir des moments d’intervention optimaux.
Troubles de la mémoire
Nature du trouble
- Dans la MCL, la mémoire est souvent relativement préservée dans les stades précoces, contrairement à la maladie d’Alzheimer.
- Il y a des difficultés d’encodage ou de récupération liées aux troubles exécutifs (par exemple, stratégie d’accès aux informations) : on parle d’« oubli organisationnel ».
- En progression, la mémoire se détériore plus nettement.
Implications pour la prise en charge
- Mettre en place des aides à la mémoire : agendas visuels, rappels (alarme, affiche), carnet de mémoire, photographie des événements ou personnes.
- Favoriser l’utilisation de récupération guidée : donner des indices (« rappel sémantique ») plutôt que compter uniquement sur la mémoire libre. Ceci est pertinent dans la MCL où la récupération est plus perturbée que le stockage pur.
- Encourager la répétition espacée, la reminiscence (souvenirs personnels) et des activités engageantes pour stimuler la mémoire.
- Adapter les objectifs : plus récupération ou maintien que réhabilitation profonde. L’accent est mis sur la compensation et l’organisation plutôt que sur le « retour au niveau antérieur ».
- Former les proches à la patience et à l’environnement sans surcharge cognitive (limiter distractions, permettre concentration, donner du temps).
Principes communs de prise en charge
- Avant tout, exclure ou corriger les facteurs aggravants (confusion, infections, médicaments anticholinergiques, déshydratation).
- Utiliser des interventions non pharmacologiques de base : stimulation cognitive (adaptée), activité physique régulière, environnement structuré et prévisible.
- Concernant le traitement médicamenteux : les inhibiteurs de la cholinestérase peuvent être indiqués dans la MCL pour les symptômes cognitifs.
- Adapter l’intervention au profil fluctuant de la MCL : les capacités peuvent varier d’un moment à l’autre, ce qui nécessite flexibilité dans la prise en charge.
- Travailler en équipe interdisciplinaire : neurologue/psychiatre, neuropsychologue, ergothérapeute, orthophoniste, aidants familiaux.
- Mettre l’accent sur la qualité de vie, l’adaptation de l’environnement et le soutien aux aidants.
La prise en charge des troubles cognitifs dans la MCL nécessite une approche multidimensionnelle, ciblée sur les particularités suivantes : prédominance des troubles visuo‑spatiaux et exécutifs, mémoire relativement préservée au départ, langage moins touché initialement mais susceptible d’évoluer.
L’intervention vise davantage à compenser et adapter l’environnement qu’à restaurer entièrement les fonctions. Une reconnaissance précoce de ces profils cognitifs permet d’optimiser l’accompagnement, de mieux anticiper les besoins et d’ajuster les stratégies thérapeutiques.
Tableau des stratégies d’intervention cognitives – Maladie à corps de Lewy
| Domaine cognitif | Manifestations fréquentes | Stratégies d’intervention | Exemples pratiques |
|---|---|---|---|
| Visuo-spatial / Visuo-perceptif | – Difficulté à reconnaître les objets dans l’espace – Désorientation dans les lieux – Difficulté à juger les distances – Confusions visuelles (ex. tapis = trou) – Hallucinations visuelles fréquentes | – Adapter l’environnement visuel – Utiliser des contrastes visuels forts – Réduire les stimuli inutiles – Exercices ciblés visuo-perceptifs – Aménagement de l’espace | – Marquer les contours des marches avec du ruban adhésif coloré – Placer des pictogrammes sur les portes (toilettes, cuisine) – Éviter les motifs complexes au sol ou sur les murs – Exercice de reproduction de figures géométriques simples |
| Langage | – Diminution de la fluence verbale – Difficulté à trouver les mots – Phrases moins structurées en période de fluctuation – Trouble de la compréhension verbale complexe | – Favoriser la communication simple et claire – Donner plus de temps pour répondre – Utiliser des supports visuels – Stimuler la fluence par des jeux de mots simples – Travailler avec un(e) orthophoniste | – Utiliser des photos pour faciliter la conversation – Jeux de catégories (nommer des animaux, objets rouges, etc.) – Poser des questions fermées (« veux-tu du thé ? » plutôt que « que veux-tu boire ? ») – Créer un carnet imagé des mots fréquents |
| Fonctions exécutives | – Difficulté à planifier et organiser une tâche – Trouble de l’initiation ou de la flexibilité – Fatigabilité mentale rapide – Désorientation dans les routines | – Utiliser des routines stables – Structurer les journées – Aides visuelles et séquentielles – Réduire les doubles tâches – Valoriser les initiatives même simples | – Affichage d’un planning journalier avec pictogrammes – Liste de tâches étape par étape (ex. pour se laver) – Favoriser les activités simples et connues (faire un gâteau avec une fiche recette imagée) – Jeux simples de résolution de problèmes (ex. « que fais-tu si tu perds tes clés ? ») |
| Mémoire | – Oublis ponctuels (surtout récupération plus qu’encodage) – Moins d’amnésie profonde que dans Alzheimer au début – Oublis liés aux troubles attentionnels ou exécutifs | – Apports compensatoires : carnets, alarmes, rappels – Structuration du contexte – Encourager la répétition, l’évocation avec indices – Valoriser les souvenirs anciens (plus stables) |
Conclusion : en référence à
https://www.canada.ca/fi/sante-publique/services/maladies/demence/feuille-conseils-comment-
communiquer.html (gouvernement du Canada). Télécharger le rapport complet (Format PDF, 1, 198 ko, 2 pages). Organisation : Santé Canada, Publiée : 2022-07-26
-> Cinq pistes pour communiquer avec un malade atteint d’un trouble neurocognitif.
- Appuyez – vous sur ce que vous connaissez de le malade
● Utilisez ses goûts, centres d’intérêt ou habitudes pour lui proposer des sujets de conversation ou des activités qu’il pourrait apprécier.
● Mettez l’accent sur ce qu’il peut encore faire, afin de valoriser ses capacités et maintenir son autonomie.
● Lorsqu’un choix est nécessaire, limitez les options et proposez – lui celles qui sont en accord avec ses préférences connues.
- Réduisez les distractions
● Repérez et limitez les sources de distraction visuelle ou sonore dans l’environnement.
● Vérifiez s’il existe des troubles de la vue ou de l’ouïe, et adaptez votre manière de communiquer en conséquence.
● Établissez un contact visuel pour mieux capter son attention et faciliter l’échange.
- Placez-vous face à la personne
● Ne lui parlez pas de dos ou depuis une position où elle ne peut pas vous voir.
● Parlez lentement, clairement, en utilisant des phrases simples et courtes.
● Accompagnez vos paroles de gestes ou de démonstrations pour renforcer la compréhension.
- Faites preuve de flexibilité
● Les capacités de la personne peuvent varier d’un jour à l’autre. Commencez chaque échange en observant son état du moment.
● Soyez attentif à son langage corporel ou à tout changement de comportement pouvant indiquer un inconfort ou une émotion.
● Si la communication verbale devient difficile, utilisez d’autres canaux sensoriels : le toucher, le regard, une odeur familière, une musique douce…
- Restez dans une posture positive
● Soyez attentif au ton de votre voix et à votre attitude corporelle. Ce que vous exprimez non verbalement est souvent plus important que les mots.
● Plutôt que de corriger, accueillez ce qui est dit et encouragez autant que possible.
● Si vous vous sentez dépassé(e), accordez-vous une pause, respirez profondément et n’hésitez pas à demander de l’aide
Prenez soin de vous aussi ! L’accompagnement d’une personne malade demande de l’énergie : vous avez le droit de vous ménager et de demander du soutien.