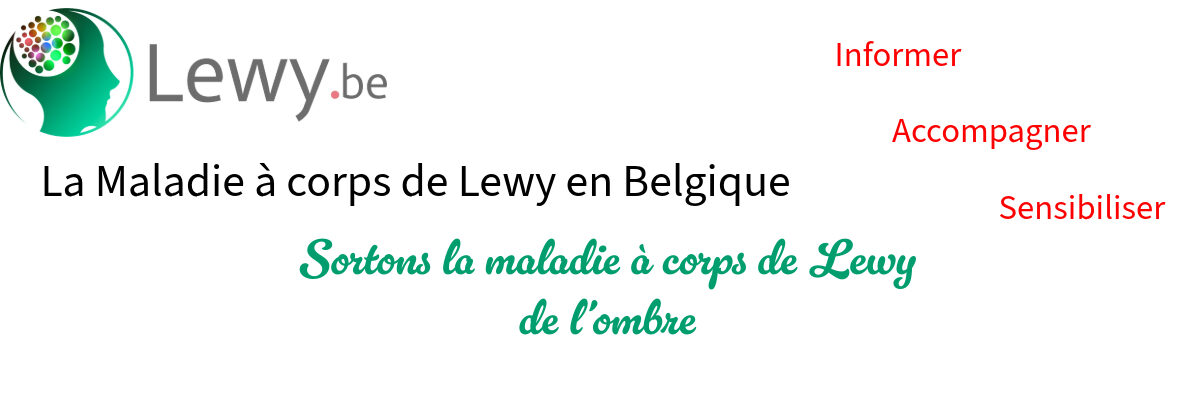Views: 8
La MCL, avec ses fluctuations, ses manifestations imprévisibles et ses effets progressifs, déstabilise en profondeur la cellule familiale. Le foyer, autrefois lieu de stabilité, devient parfois un espace de tensions, de découragement, voire de rupture. Pourtant, il peut aussi rester un espace de soutien, de résilience et de lien, à condition d’être conscient des défis et d’oser les nommer.
Ce qui menace l’équilibre familial
- La répartition des rôles se modifie brutalement : un conjoint devient aidant, un enfant devient observateur silencieux d’un parent qui change, un frère ou une sœur se sent exclu ou submergé.
- Les émotions sont intenses et contradictoires : colère, culpabilité, impuissance, tristesse… mais aussi amour, attachement, peur de mal faire.
- Le temps et l’énergie manquent pour la communication, les loisirs communs, les instants de détente nécessaires à la régulation du stress.
- Le regard extérieur (amis, famille éloignée) peut être décalé, voire blessant, ce qui accentue l’isolement et le sentiment d’injustice du noyau familial.
- Les enfants, petits ou adolescents, peuvent être exposés à des scènes confuses, des silences pesants, voire des conflits. Ils peuvent intérioriser leur détresse, se sentir responsables, ou développer un mal-être.
Ce qui peut soutenir et protéger la famille
- Parler vrai, dans des mots adaptés à chacun, sans dramatiser mais sans minimiser non plus. Ce que l’on nomme devient plus supportable.
- Reconnaître les émotions de chacun sans jugement : il n’y a pas de « bonne » façon de réagir à la maladie.
- Répartir les responsabilités, même modestement, pour éviter que tout repose sur une seule personne.
- Donner une place aux enfants dans le lien, mais pas dans la charge. Leur expliquer, les écouter, leur permettre de continuer à vivre leur vie d’enfant.
- Préserver des temps “hors maladie” : un repas joyeux, une sortie en duo avec l’enfant non aidant, un moment de répit à l’extérieur. Ces bulles sont vitales.
- S’autoriser à demander de l’aide (professionnelle, familiale, associative). Une famille n’a pas à tout porter seule.
Quand la famille reste un socle
Préserver le noyau familial ne signifie pas qu’il reste intact, mais qu’il trouve un nouvel équilibre, mouvant mais solide.
Cela demande du temps, du soutien, de l’écoute — et parfois, le simple droit de ne pas toujours y arriver.
Mais quand les liens résistent — même fragiles, même maladroits — ils deviennent un appui précieux pour le malade comme pour l’aidant. Ils permettent à chacun de traverser cette épreuve en restant ensemble, humainement reliés.
Alors que dans la maladie d’Alzheimer, les capacités langagières se perdent, dans la MCL, même si le malade a des difficultés pour entrer en dialogue avec ses proches, il n’y a pas de perte du langage (sauf dans les cas où la MCL est associée à Alzheimer).
Par contre, il y a très tôt dans la maladie, une fragilité de la cognition sociale qui entraîne pour le malade une baisse de la conscience de soi et une difficulté plus importante à rentrer en résonance avec ses proches. C’est-à-dire que le malade a probablement plus de difficultés à être touché par le monde et qu’il rencontre aussi des difficultés pour agir sur le monde.
L’adaptation progressive du proche : une résonance à ajuster
Au fil de l’évolution de la maladie, le proche aidant doit continuellement ajuster sa façon d’entrer en relation, en s’accordant aux modifications subtiles — ou parfois brutales — de la résonance » émotionnelle et cognitive de la personne malade.
Cela demande de reconnaître que la relation ne repose plus sur des échanges logiques ou symétriques, mais sur une écoute fine, sensible, respectueuse du rythme et de la réalité de l’autre. Rester en communication, même dans la confusion ou le silence, sans rompre le lien, devient alors un acte central du « prendre soin ».
C’est aussi souvent le dernier espace sur lequel le proche garde une forme de pouvoir, lorsque tout le reste semble lui échapper : la qualité de la relation