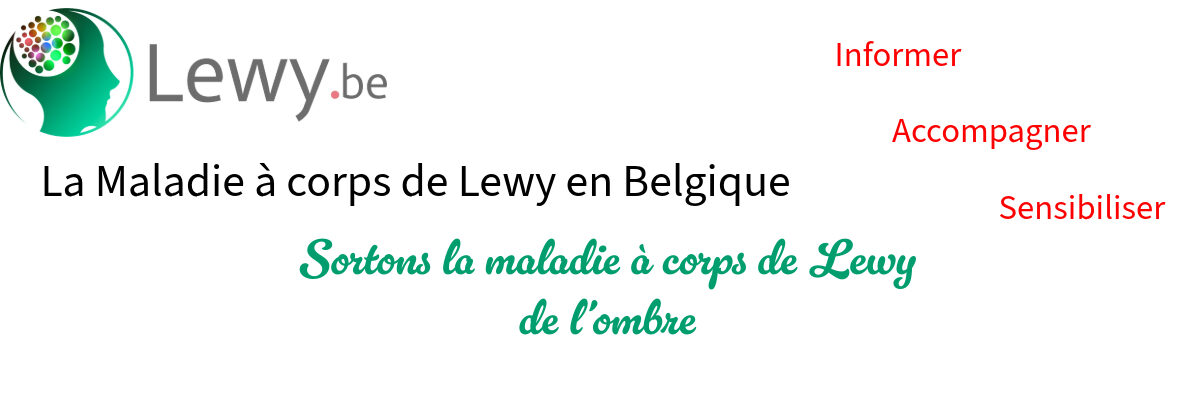La MCL : une maladie neuroévolutive complexe parce qu’elle touche plusieurs zones du cerveau.
Elle est causée par la présence et l’accumulation de dépôts anormaux d’une protéine de conformation anormale appelée alpha-synucléine, qui perturbent le bon fonctionnement des cellules nerveuses et cause une souffrance cérébrale.
Les symptômes varient d’un patient à l’autre, selon les régions du cerveau atteintes.
La MCL partage certaines caractéristiques avec la maladie de Parkinson, notamment la présence des mêmes dépôts, appelés corps de Lewy.
Une maladie neuroévolutive encore méconnue
Une reconnaissance clinique tardive
Les corps de Lewy, ces dépôts anormaux de protéines dans le cerveau, ont été découverts dès 1912. Cependant, il a fallu attendre les années 1980-1990 pour que leur lien avec une maladie spécifique soit clairement établi.
Ce sont des équipes japonaises et occidentales qui ont, à cette époque, défini pour la première fois la « démence à corps de Lewy » comme une entité clinique distincte, bien qu’elle partage des points communs avec la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson.
Une maladie encore trop souvent sous-estimée
Malgré cette reconnaissance relativement récente (il y a un peu plus de 40 ans), la MCL reste encore largement méconnue, même parmi les professionnels de santé.
Cette méconnaissance contribue directement à un diagnostic tardif ou erroné, et donc à une prise en charge inadaptée pour de nombreux malades.
👉 Rendre cette maladie plus visible est donc un enjeu majeur de santé publique, pour permettre un repérage plus précoce, une meilleure orientation des patients, et un soutien plus adapté aux aidants.
Une maladie aux multiples visages
La MCL se manifeste par un ensemble de symptômes variés qui peuvent évoluer dans le temps et différer d’une personne à l’autre. Elle touche à la fois les fonctions cognitives, les capacités motrices, le comportement, et certaines fonctions corporelles automatiques.
Parmi les signes les plus fréquents, on retrouve :
• Des troubles cognitifs : difficulté à réfléchir, à raisonner ou à se concentrer,
• Des fluctuations mentales : moments d’alerte alternant avec des phases de confusion ou d’absence,
• Des hallucinations, le plus souvent visuelles,
• Des délires ou idées fausses persistantes,
• Des troubles du sommeil, notamment des comportements nocturnes agités en lien avec un sommeil paradoxal perturbé,
• Des symptômes moteurs : rigidité, lenteur des mouvements, tremblements,
• De la désorientation dans le temps ou l’espace,
• De l’anxiété,
• Une constipation persistante,
• Des troubles urinaires, souvent précoces…
⚠️Des symptômes souvent trompeurs
Les premiers signes de la MCL sont souvent confondus avec ceux d’autres maladies comme la dépression ou la bipolarité voir la schizophrénie, la maladie d’Alzheimer ou la maladie de Parkinson. Cette confusion est fréquente car les manifestations initiales peuvent être subtiles et non spécifiques.
Cette confusion peut mener à des erreurs thérapeutiques graves : en particulier, l’usage de neuroleptiques (médicaments antipsychotiques) est hautement risqué dans le cadre de la MCL, car il peut aggraver les symptômes moteurs et cognitifs, voire entraîner des effets secondaires potentiellement mortels.
Une maladie difficile à vivre
La MCL est une expérience éprouvante à la fois pour la personne malade et son entourage. Les symptômes sont multiples, instables et parfois déconcertants, ce qui peut rendre le diagnostic tardif et la prise en charge compliquée.
👉 Mais en comprenant mieux la maladie, en reconnaissant ses signes précoces et en s’appuyant sur les bons professionnels, il est possible d’améliorer la qualité de vie du malade et de soutenir efficacement les aidants.
Une maladie particulièrement déstabilisante
A tous ces symptômes s’ajoute une caractéristique déroutante : les fluctuations de la MCL.
Les jours — et même les heures — ne se ressemblent pas. Une personne peut passer en quelques heures d’un état apparemment normal à une confusion marquée, puis revenir à un meilleur état, parfois de manière inattendue, ce qui désoriente souvent les proches.
👉 Reconnaître ces changements rapides et imprévisibles est essentiel pour mieux adapter l’accompagnement, limiter les malentendus, et offrir au malade un environnement aussi sécurisant et compréhensif que possible.
Une expérience douloureuse
La MCL confronte le malade à une réalité particulièrement difficile : il perçoit peu à peu la perte de contrôle sur sa vie, tout en gardant, dans bien des cas, une lucidité partielle sur la dégradation de son état.
Cette conscience intermittente de ses difficultés peut provoquer angoisse, frustration ou tristesse. De leur côté, les proches assistent impuissants à cette évolution, souvent déstabilisés par les hauts et les bas de la maladie, sans toujours savoir comment aider ni comment réagir.
👉 Face à cette incertitude permanente, un accompagnement bienveillant et informé est essentiel, autant pour la personne atteinte que pour ceux qui l’entourent.
Quel traitement ?
À ce jour, il n’existe pas de traitement curatif pour la MCL. La prise en charge repose sur le traitement des symptômes.
Une approche pluridisciplinaire (médecin, kiné, ergothérapeute, orthophoniste, psychologue…) est essentielle pour accompagner le malade dans l’évolution de sa maladie.