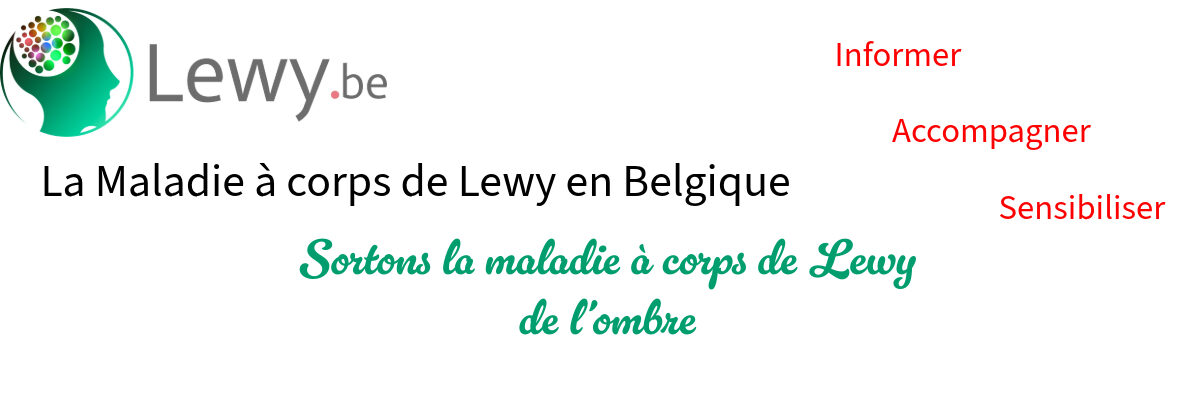La loi dépénalisant l’euthanasie ne s’applique pas en cas d’arrêt de traitement ou de décision de ne pas entamer un traitement. Dans ces cas, le médecin n’interrompt pas délibérément la vie. Ces actes tombent sous le champ d’application de la « loi relative aux droits du patient ».
Cette loi permet à la personne d’une part, de refuser un traitement et toute obstination déraisonnable et, d’autre part, au médecin de répondre favorablement à un tel refus sans crainte d’être accusé de ne pas avoir utilisé toutes les possibilités médicales de traitement.
La déclaration anticipée de refus de traitements (nommée également déclaration anticipée négative) diffère donc sensiblement de la déclaration anticipée d’euthanasie. On dit ainsi que cette déclaration est un complément à celle d’euthanasie car on peut être incapable d’exprimer sa volonté sans pour autant être inconscient.
La déclaration anticipée de refus de traitements est destinée à préciser les traitements que l’on refuse dans le cas où l’on serait incapable de s’exprimer, soit de manière temporaire, soit définitivement.
A titre d’exemples : refus d’alimentation artificielle (en cas d’incapacité à s’alimenter par ses propres moyens), de respirateur automatique, de réanimation (en cas d’arrêt cardiaque), etc.
Il est conseillé d’en parler et de compléter ces refus particuliers avec le médecin traitant. Si la personne le souhaite, elle peut y désigner un ou plusieurs mandataires qui, en signant ce document, acceptent de la représenter pour l’exercice de ses droits de patient , notamment pour faire respecter ses refus de traitements.
La déclaration anticipée de refus de traitements (ou négative) a une durée de validité illimitée. Tout comme les autres déclarations anticipées, elle peut être révisée ou retirée à tout moment. Il est conseillé d’en conserver un exemplaire et d’en remettre un à chaque mandataire éventuellement désigné ainsi qu’à son médecin traitant.
Contrairement à la déclaration anticipée d’euthanasie, cette déclaration ne peut pas être enregistrée auprès de l’administration communale. Le pouvoir législatif n’a pas prévu de formulaire officiel.
Comment faire pour remplir une déclaration anticipée de refus de traitements ?
Un modèle de formulaire de déclaration anticipée négative est disponible sur le site internet du LEIF (LevensEinde InformatieForum)7. Aucune présence de témoin n’est requise pour remplir cette déclaration.
Parlez – en à votre médecin : il vous aidera à mieux préciser et consigner, sur votre
déclaration, les traitements particuliers que vous voudriez refuser.
Notez que l’ADMD (Association pour le droit de mourir dans la dignité) propose
à ses membres les deux types de déclarations anticipées (d’euthanasie et de refus
de traitements) et leur donne tous les conseils utiles pour assurer le respect de
celles-ci.
Point d’attention : une déclaration relative aux traitements peut également être positive (c.-à-d. pour préciser les traitements que l’on souhaite). Il peut s’agir de confirmer un souhait de sédation d’urgence en cas de symptôme insupportable et réfractaire aux traitements usuels, ou encore solliciter le soulagement de douleurs, y compris à des doses potentiellement dangereuses.
Enfin, il est généralement utile de préciser les objectifs de soins individualisés, centrés sur le patient , plutôt que sur la maladie (préserver la qualité de vie ou viser un soulagement optimal des symptômes, par exemple).